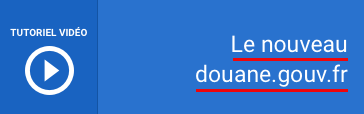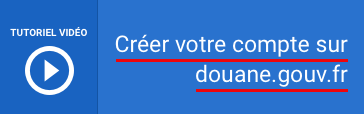Foire aux questions
Questions fréquentes
Les DEB doivent faire l’objet de corrections lorsque des erreurs sont décelées après leur transmission aux services douaniers. Les modifications doivent être portées à la connaissance de l’administration jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant la date de la déclaration concernée.
1) À l'introduction
Une DEB de rectification est exigée si la modification entraîne une variation (de plus ou en moins) de la valeur de plus de 8000 euros, ou concerne une information autre que la valeur, cette dernière étant supérieure à 16 000 €.
2) À l'expédition
Lorsque la correction porte sur la valeur fiscale, le régime ou le numéro d'identification de l'acquéreur, une DEB de rectification doit être produite quelle que soit la valeur.
Lorsque la modification concerne d'autres données, une DEB de rectification ne doit être produite que si la valeur est supérieure à 16 000 euros.
- Dans certains cas, il est nécessaire de supprimer une DEB déposée.
Le déclarant doit déposer une déclaration de suppression de DEB dans les cas suivants :
- Erreur sur l’année de déclaration : selon que l'erreur concerne toutes les lignes de la DEB ou seulement certaines, il convient de supprimer totalement ou partiellement la déclaration initiale, et d'établir une nouvelle déclaration comportant toutes les données de l’ancienne.
- Erreur sur le redevable de la DEB : selon que l'erreur concerne toutes les lignes de la DEB ou seulement certaines, il convient de supprimer totalement ou partiellement la déclaration établie sous un mauvais numéro de TVA. Une nouvelle DEB doit être créée sous le numéro de TVA correct.
- Double prise en compte d'un même flux : (exemple : le flux a été déclaré à la fois par le propriétaire des biens et par le façonnier), ou au contraire dépôt d’une DEB pour une opération qui ne correspondait pas à un flux intracommunautaire (ex : vente interne, importation ou exportation…). Selon que l'erreur concerne toutes les lignes de la DEB ou seulement certaines, il convient de supprimer totalement ou partiellement la déclaration initiale.
Les corrections sont effectuées soit à l'initiative du déclarant, soit sur demande des centres de collecte après l'enregistrement des déclarations initiales. Elles peuvent être établies sous forme papier ou donner lieu à des corrections en ligne via le service en ligne DEB.
Le service en ligne offre aux entreprises la possibilité de modifier ou de supprimer en ligne toutes les déclarations qu’elles ont déposées au cours des 6 dernières années, quel que soit le support utilisé initialement (DEB papier, fichiers transmis par messagerie, déclarations transmises via le service en ligne).
En cas d’accès indisponible à CIEL, se rapprocher de son service pour obtenir des informations quant à la nature au le délai de l’indisponibilité. Il est également préconisé de se reconnecter régulièrement.
Il sera possible de déposer sa déclaration sur CIEL dès que le service en ligne sera à nouveau disponible, sans déposer de déclaration papier.
En tout état de cause, aucun retard de dépôt ne pourra être imputé en cas d’indisponibilité de CIEL.
Il n'existe pas de modèle d'écritures de suivi. Le titulaire de l'autorisation d'entrepôt douanier doit toutefois veiller à inscrire dans les écritures les quantités et natures des biens placés sous le régime, en mentionnant toute spécificité au plan douanier (présence d’un certificat d’origine, régime précédent, etc.).
L'origine non préférentielle est l'origine de droit commun d'une marchandise, sa « nationalité ». Elle sert à appliquer le tarif extérieur commun (TEC), les mesures de politique commerciale et, si vous le souhaitez, un marquage de type « Made in/Produit en » sur votre produit.
L'origine préférentielle est une origine « bonus » sollicitée à l'import dans l'UE ou dans un pays partenaire avec lequel il existe un accord commercial ou à qui l'UE concède des préférences unilatérales. Elle nécessite la présentation d'une preuve d'origine. Le type de preuve d'origine à présenter dépend de l'accord concerné et du montant de l'envoi : certificat EUR.1, attestation ou déclaration d'origine sur document commercial.
Trouvez la réponse à vos questions !
Parce que !
Toutes les marchandises
L’enquête mensuelle sur les échanges de biens intra-Union Européenne (EMEBI) remplace à partir du mois de référence 2022 le volet statistique de la déclaration d’échanges de biens (DEB) pour tous les échanges intra-UE de marchandises réalisés au cours de l’année.
Cette enquête fondée sur la loi statistique de 1951 (loi 51-711 modifiée) suit les procédures de déclaration et d’homologation de la statistique (avis d’opportunité du Conseil national de l’information statistique, examen par le Comité du Label de la statistique publique). Elle est intégrée chaque année au sein d’un arrêté relatif au programme annuel d’enquêtes sur les entreprises de la statistique publique.
Comme dans toute enquête statistique, une liste des sociétés qui sont soumises à l’enquête chaque année est définie. Cette liste est appelée « échantillon ». Seules les sociétés qui font partie de l’échantillon sélectionné et qui ont reçu au préalable la lettre-avis les informant de leur obligation de réponse à l’enquête sont redevables de la réponse à l’enquête statistique EMEBI.
Les informations statistiques ainsi transmises sont protégées par l’article 6 de la loi 51-711 (révisée) sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui stipule au troisième alinea du paragraphe II que « Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique ».
L’EMEBI permet d’établir le chiffre mensuel du commerce extérieur de la France et constitue une source d'information essentielle pour de nombreux acteurs économiques et pour le suivi de l’activé économique de la nation. Elle permet à l’administration de recueillir des informations relatives aux flux physiques de marchandises au sein de l’Union européenne, malgré la suppression des frontières douanières par la mise en œuvre du marché intérieur le 1er janvier 1993. Depuis cette date, les échanges intra-UE de biens ne sont en effet plus couverts par des déclarations en douane (DAU).
La détaxe désigne la réduction ou suppression d’une taxe, souvent appliquée à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur certains achats.
🇫🇷 En France, pour les touristes
Si tu résides hors de l’Union européenne et que tu fais des achats en France, tu peux bénéficier d’une exonération de TVA sur certains produits, à condition de les exporter hors de l’UE.
✅ Conditions pour bénéficier de la détaxe :
- Avoir plus de 16 ans
- Résider hors de l’UE
- Dépenser plus de 100,01 € dans un même magasin le même jour
- Quitter l’UE dans les 3 mois suivant l’achat
- Présenter les marchandises à la douane lors du départ
🛍️ Comment ça marche ?
- Le commerçant te remet un bordereau de vente en détaxe (souvent avec le système PABLO).
- Tu valides ce bordereau à une borne ou auprès des douanes à l’aéroport.
- Le commerçant ou un service de détaxe te rembourse ensuite la TVA.
Attention : ce n’est pas la douane qui rembourse, mais bien le vendeur ou un prestataire privé.
La demande peut être établie sur papier libre à condition qu'elle reprenne les données obligatoires de l'annexe A du règlement délégué 2016/2446 du 28/07/2015.
Ces données sont le code de la demande (REP ou REM), le titre pour le recouvrement, l'identification du demandeur (et de son représentant, le cas échéant), le bureau de douane où la dette douanière a été notifiée, le code des marchandises, la désignation des marchandises, les quantités de marchandises, la valeur en douane, le montant des droits à rembourser ou à remettre, le type de droits à l’importation, la base juridique, la banque et les coordonnées bancaires, les documents joints (le seul document obligatoire à ce stade est l’attestation relative à usage certificat d’importation), le motif du remboursement ou de la remise, la date et signature.
Non, seuls les transferts physiques sont soumis à déclaration au titre de l'obligation déclarative des transferts de sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros prévue par l'article 464 du code des douanes et le règlement européen 1889/2005 du parlement et du Conseil.
Si vous êtes un particulier, vous n’avez pas à déposer de DEB pour couvrir vos échanges intracommunautaires, car vous ne disposez pas de numéro d’immatriculation à la TVA. Le vendeur doit par conséquent facturer les biens TTC.
- Le régime particulier des personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD)
Les personnes bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD), telles que les personnes morales non assujetties ou les administrations publiques, ne sont pas tenues de transmettre de DEB, ni à l'expédition ni à l'introduction. Les PBRD bénéficient en effet d’un régime dérogatoire leur permettant de ne pas soumettre leurs achats intracommunautaires à la TVA tant que le montant de ces achats ne dépasse pas 10 000 euros par an. Les acquisitions en dessous du seuil de 10 000 euros sont traitées comme les achats des particuliers, la taxation se situant exclusivement au niveau du fournisseur lors de la livraison.
Au-delà du seuil de 10 000 euros, ces acquisitions suivent le régime général des acquisitions intracommunautaires et ces personnes doivent avoir un numéro d'identification à la TVA. La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires taxables doit obligatoirement être liquidée et déclarée sur les déclarations de chiffre d’affaires CA3.
Pour apprécier le seuil de 10 000 euros, on retient le total, hors TVA, des acquisitions (autres que des moyens de transport neufs et de produits soumis à accises) ayant donné lieu, dans un autre État membre, à une livraison soumise à la TVA par le vendeur dans cet État (à l’exception des livraisons exonérées dans ledit État). Le régime dérogatoire s’applique si le montant d’achats ainsi déterminé n’a pas excédé durant l'année précédente, et n’excède pas durant l’année en cours, le seuil de 10 000 euros.
- Parmi les PBRD : les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA
Il s’agit des autoentrepreneurs et des micro-entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils (82 200 euros pour livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d’hébergement / 32 900 euros pour les autres prestations de services / 42 600 euros pour les activités des avocats, avoués, artistes interprètes).
- Le cas des auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs bénéficient du régime de la franchise en base et sont à ce titre dispensés de DEB.
Les auto-entrepreneurs ne sont pas immatriculés à la TVA car ils n'ont pas l'obligation de collecter la taxe ; ils se comportent comme des particuliers au regard de la TVA.
Il doit respecter les mêmes conditions qu’une PBRD pour bénéficier de la dispense de DEB (seuils de chiffre d’affaires). Lorsqu'un auto-entrepreneur ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la franchise en base, il doit se comporter comme un assujetti « classique » et doit s'identifier à la TVA.
Les codes régime permettent de déterminer la nature de la DEB : fiscale et statistique, fiscale uniquement ou statistique uniquement.
C'est donc en fonction du code régime que l'administration des douanes décide du traitement qu'elle va appliquer aux opérations : alimentation ou non de la base VIES (système d’échange d’informations en matière de TVA instauré par les États membres de l'UE) et prise en compte ou non de l'opération dans les statistiques du commerce extérieur.
Ainsi, à l'expédition, seules les déclarations en code régime 21, 25, 26 et 31 constituent des déclarations fiscales qui alimentent la base de données européenne VIES.
À l'inverse, les DEB établies en code régime 29 ne correspondent pas à des livraisons intracommunautaires et sont prises en compte uniquement à des fins statistiques.
À l'introduction, les DEB sont exclusivement statistiques puisque la base VIES ne reprend que les livraisons intracommunautaires. Mais le code régime permet de distinguer les flux qui s'analysent fiscalement comme des acquisitions intracommunautaires ou assimilées repris sous le code régime 11, des autres flux repris sous le code régime 19 (flux de biens pour ouvraison, marchandises exonérées de TVA…).
Cela dépend du contrat de location.
Les biens introduits ou expédiés dans le cadre d'un contrat de location-vente suivent le même régime que les biens faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire (LIC) ou d'une acquisition intracommunautaire (AIC).
La location-vente est une convention qui prévoit qu’à l'expiration d’un contrat de louage de chose, la propriété d'un bien loué sera transférée à la personne qui en était jusque-là simplement locataire. Les échéances de crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur du bien. Les risques et avantages liés à la propriété sont transférés au preneur.
Dès remise matérielle du bien, la TVA est exigible sur la totalité de la valeur du bien, comme s'il s'agissait d'une vente. En conséquence, une DEB d'expédition en code régime 21 devra être déposée par la société qui expédie un bien à destination de son client dans un autre État membre dans le cadre d'une location-vente. La valeur fiscale à reporter sera la valeur totale du bien, assise sur le montant cumulé des loyers prévus (ou le cas échéant, sur le prix prévisionnel du bien tel qu'il peut ressortir du contrat). La période de référence sera le mois au titre duquel la TVA est devenue exigible dans l'État membre d'arrivée des biens.
Corrélativement, une DEB en code régime 11 sera due par une société qui introduit des biens en France dans le cadre d'une location-vente.
Les biens introduits ou expédiés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de leasing opérationnel peuvent le cas échéant rentrer dans le cadre des flux exclus de la DEB.
Les contrats de crédit bail ou de leasing opérationnel s'analysent comme des locations, assorties pour le preneur d'une simple faculté d'achat moyennant un prix qui tient compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers.
La location constitue une prestation de service taxable à la TVA selon les règles applicables en la matière. Lorsque le crédit-bail prend fin par une vente, la TVA est exigible sur la valeur de la vente.
Dès lors, plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :
- Si la société sait que la durée de séjour sera supérieure à 24 mois : au moment du flux physique, une DEB d'introduction ou d'expédition selon le cas, doit être déposée en code régime 19 ou 29 (les flux ne correspondent pas à des LIC ou des AIC puisqu'il s'agit dans un premier temps d'une simple prestation de service). La valeur des biens sera estimée (en se basant par exemple sur la valeur assurances).
- Si la société est dans l'impossibilité de savoir, au moment du flux physique, combien de temps la location va durer ni de quelle manière elle va prendre fin : la société est dispensée de DEB au moment du flux physique. Lorsque la société constate que les conditions d'exclusion de la DEB ne sont plus réunies, soit parce que le preneur a décidé d'acheter le bien, soit parce que le délai de 24 mois est dépassé, elle doit déposer une DEB de régularisation en code régime 19. La période de référence est le mois au cours duquel il est constaté que le flux ne peut plus être dispensé de DEB.
Exemple : une société introduit en France un moyen de transport en crédit-bail en mai 2018. Au bout de 24 mois, elle décide d'acheter le bien. Elle établit une DEB d'introduction avec comme période de référence mai 2020, en code régime 19, en estimant la valeur à partir de la valeur de vente et la valeur des loyers acquittés.
Calculer le seuil à l’expédition
Le seuil de 460 000 euros est atteint si l’une des deux conditions suivantes est respectée :
- des expéditions d'un montant HT supérieur à 460 000 euros ont été réalisées au cours de l'année civile précédente ;
- ce seuil atteint en cours d'année.
Pour calculer le montant d’expéditions réalisées, prendre en compte que les opérations correspondant à des flux physiques : il s’agit donc des opérations reprises en code régime 21 et 29 pour l'expédition. Il n’y a pas lieu de comptabiliser les opérations déclarées en codes régime 25, 26 et 31.
Cas particuliers
- Les DEB établies en code régime 29 (livraisons de biens pour travail à façon ; réexpéditions de biens après travail à façon ; ventes à distance ; etc) ne sont dues que si le seuil annuel de 460 000 euros est atteint l’année précédente ou franchi en cours d’année.
- En cas d'utilisation des codes régime 31, 25 et 26, seuls la valeur fiscale et le numéro de TVA de l'acquéreur sont exigés, que le montant des échanges dépasse ou non 460 000 euros.
Calculer le seuil à l’introduction
À l'introduction, déposer une DEB qu'en présence d'un des deux cas suivants :
- au cours de l'année civile précédente, ont été réalisées des introductions d'un montant supérieur ou égal à 460 000 euros, une DEB étant exigible dès le premier mois de l'année civile en cours ;
- au cours de l'année civile précédente ont été réalisées des introductions d'un montant inférieur à 460 000 euros, mais ce seuil est franchi en cours d'année, une DEB étant exigible dès le mois de franchissement.
Pour calculer le montant d’introductions réalisées, l’entreprise ne doit prendre en compte que les opérations correspondant à des flux physiques : il s’agit donc des opérations reprises en codes régime 11 et 19 pour l'introduction.
De même, suite à une création d'entreprise ou lors du premier échange de marchandises avec un autre État membre, aucune déclaration d'introduction n'est à fournir, tant que les introductions cumulées n’atteignent pas le seuil de 460 000 euros. Ce seuil franchi, il faut transmettre des données.
La DES est une déclaration mensuelle qui permet de suivre les flux de prestations de services réalisés par des sociétés françaises dans d'autres États membres de l'UE. La DES a été créée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 et depuis le 1er janvier 2010, les entreprises françaises rendant des prestations de service à des sociétés européennes doivent établir des DES récapitulant les opérations effectuées.
Les prestations à déclarer sont celles qui donnent lieu à autoliquidation de la TVA par le preneur (acheteur) identifié dans l’autre État membre.
Elle doit être transmise à l’administration des douanes qui en assure la collecte afin de permettre le contrôle de la taxation à la TVA des prestations de services intracommunautaires. La DGFIP reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA sur les prestations de service.
Les frais de transport son pris en compte sur la DEB lorsqu’ils sont sur la même facture que celle de la marchandise. À l’inverse, ils ne sont pas à prendre en compte lorsqu’ils figurent sur une facture différente.
Selon l’article 267 du CGI, les frais de transport que le fournisseur facture à l'acquéreur, constituent en principe des frais accessoires à la livraison d’un bien : « sont à comprendre dans la base d’imposition […] les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients ».
Les frais de transport doivent en principe être inclus dans la base d'imposition de la TVA, sauf si le vendeur et l'acheteur ont entendu expressément disjoindre la prestation de transport de la vente du bien elle-même. C'est donc à la société de décider si les frais de transport doivent ou non suivre le même régime que le bien, et remplir sa déclaration fiscale (CA3) en conséquence.
La DEB doit ensuite être établie en cohérence avec la CA3 :
- si les frais de transport sont inclus dans la valeur fiscale de la vente reportée en ligne 6 de la CA3 (ligne indiquant le montant des livraisons intracommunautaires), la valeur déclarée en DEB inclut ces frais de transport ;
- si les frais de transport sont traités sur CA3 comme des prestations de service indépendantes, la valeur déclarée en DEB n'inclut pas les frais de transport.
Exemples :
Si un vendeur facture uniquement la marchandise et décide de ne pas prendre en charge le transport (Incoterm EXW), la valeur fiscale reportée en DEB et en CA3 ne comprendra que la valeur des biens.
À l'inverse, si un vendeur facture non seulement le bien mais également l'ensemble des frais transport jusqu'à destination (Incoterm DDP), c'est cette valeur facturée qui devra être indiquée en DEB et sur la CA3.
Il existe cependant une exception à cette règle: le prix du transport peut être dissocié du montant de la vente et être soumis aux opérations de transport , à condition qu'il constitue la rémunération effective et normale d'une prestation de service que le vendeur et l'acquéreur ont entendu expressément disjoindre et rémunérer distinctement de l'opération de vente elle-même.
Le cas échéant, les frais de transport devront alors être repris en DES.
Infos Douane Service
Nous vous renseignons sur les formalités douanières pour les particuliers et les professionnels.Nos conseillers douaniers sont disponibles du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 8h30 à 18h00.
Le rappel est gratuit et le numéro affiché est 0 800 94 40 40.
Appels depuis les Outre-mer ou l'étranger : +33 1 72 40 78 50.